
Martine LE BEC-CABONH2o – mars 2003
Près de 24 000 participants, 182 pays représentés, 351 sessions de travail, 38 sujets abordés. Cela fait beaucoup, beaucoup trop pour obtenir des choses concrètes. Au total, le 3ème Forum mondial de l'eau s'est achevé le dimanche 23 mars sur un bilan plutôt maigre. La déclaration adoptée par les ministres de 96 pays affirme que tout doit être fait pour préserver et contrôler l'approvisionnement en eau de la planète. En revanche, elle annonce très peu de projets concrets pour y parvenir.
Aussi, à l'heure de la fermeture des halls, à Kyoto, l'horloge de la maison des citoyens est désespérément restée bloquée sur 1 220 000 000 - le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable.
En réalité que peut-on reprocher à Kyoto ? Une grande excellence dans les chiffres, face à laquelle de vagues considérations humanitaires ne font pas le poids. De là aussi les violentes critiques que s'attirent parfois ceux qui tiennent les premiers rôles dans ce type d'événement - que ce soit à La Haye, à Johannesburg ou à Kyoto, à savoir : le Conseil Mondial de l'Eau et – même si plus modestement, le Global Water Partnership.
Une contribution importante du Forum de Kyoto aura probablement été le rapport "Financer l'eau pour tous" du panel Camdessus, diffusé dix jours avant l'ouverture du Forum. La qualité du président, ex-directeur du Fonds monétaire international, n'est pas sans doute étrangère à la réaction suscitée auprès de nombreuses ONG qui ont d'emblée rejeté le travail, craignant la mainmise du secteur privé sur l'eau. Mais paradoxalement nombre de gouvernements et d’institutions internationales risquent eux-mêmes de faire obstacle au rapport qui préconise d’importants changements de comportements . Une contrainte qui va de pair avec la nécessaire décentralisation du financement des politiques de l'eau. La critique des ONG se focalise plus directement sur le concept de PPP – partenariat public privé. Le concept est apparu clairement lors du précédent forum à La Haye, en mars 2000 ; il a ensuite été "officialisé" lors de la Conférence ministérielle de Bonn, en décembre 2001 puis très médiatisé au Sommet de Johannesburg qui restera dans les annales comme Le Sommet des Partenariats.
Comme le précise le rapport Camdessus, les PPP qui visent à être un levier pour attirer les investissements privés, "imposent de rendre l'eau plus attrayante aux yeux des investisseurs ; ils nécessitent un cadre réglementaire et juridique adapté, des modalités contractuelles transparentes, des mécanismes de récupération des coûts fiables et l'acceptation par le grand public". Les opposants "doutent" profondément (le mot est faible) de la transparence ici énoncée. Selon eux les PPP sont seulement un instrument de plus au service de la Banque mondiale et des investisseurs privés pour investir de nouveaux marchés, un instrument qui se situe dans le droit fil du modèle IWRM, Integrated Water Resources Management. C'est de fait par le biais de mécanismes de la sorte que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont favorisé depuis vingt-cinq ans la prise de contrôle par les multinationales de la plupart des ressources naturelles en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. En définitive, les PPP favoriseraient surtout la marchandisation des biens et services.
On touche là au coeur de la polémique engendrée par l'AGCS (GATS en anglais), l'Accord général sur le commerce des services. Au-delà des World Water Warriors les plus acharnés, de nombreuses ONG réclament que l'eau soit exclue du GATS. À ce stade du débat international – tout juste émergeant – les enjeux sont encore mal identifiés par la plupart des acteurs et qui plus est par le grand public. Il n'en va pas de même pour tous, et sûrement des grandes puissances, à l'instar des États-Unis qui dans la perspective d'un éventuel transfert massif d'eau a déjà entamé un recensement des ressources andines (voir ResSources). Si on est là très loin des images grand public de remorquage d'icebergs vers les riches pays du Golfe arabo-persique, la réalité demeure ; les technologies sont opérationnelles comme en témoigne le programme de la Grande Rivière Artificielle en Libye (cf. le reportage en Libye de h2o, publié par Libération dans son édition du 22 et 23 mars 2003). Qu'il soit question aujourd'hui d'évaluation des réserves, notamment dans le cas des aquifères souterrains, d'exploitation des gisements ou de transferts de l'eau sur des longues distances, les méthodes et technologies demandent seulement d'être peaufinées pour être rentables. Ce n'est plus de la science-fiction.
Néanmoins si les projets fascinent les ingénieurs et les stratèges, le grand public se montre assez réticent sur la question. Tout le monde sent bien qu'il y a là quelque chose de fondamentalement "contre-nature". Et le droit à l'eau – ou le droit de l'eau, dans tout cela ?
Pour le coup Kyoto aura une nouvelle fois été très décevant. Les ministres réunis à Kyoto ont refusé d’accorder à l’eau le statut de "droit de l'Homme". Les spécialistes diront que le débat est dépassé. L'eau n'a pas besoin de Kyoto pour figurer au rang des droits fondamentaux et imprescriptibles de la personne. Plusieurs textes internationaux l'ont (bien qu'implicitement) reconnu. Nous citerons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) signé en 1966 ou plus récemment – et cette fois de manière parfaitement explicite, la déclaration du 4 décembre dernier du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. Alors pourquoi les gouvernements continuent-ils de rejeter cette revendication ? Qu'importe d'ailleurs ici l'attitude des ministres présents à Kyoto, car c'est évidemment l'opportunité manquée du Sommet de Johannesburg qui nous chagrine le plus. On comprendra que les revendications qui découleraient du droit à l'eau mettraient immanquablement certains gouvernements en mauvaise posture, notamment dans les pays les plus pauvres et les plus menacés. Mais cette façon de persister à s'opposer à "l'existant" juridique international est quelque part anachronique et agaçante.
Que réclament en conséquence les World Water Warriors ? Bien sûr l'exclusion de l'eau des négociations de l'OMC/AGCS (s'agissant de l'eau, synonymes d'une "marchandisation de la vie") ; mais plus loin aussi la création d'une Autorité mondiale de l’eau, constituée sur des bases démocratiques et représentatives, et recouvrant les trois compétences : législative (un Parlement mondial de l’eau, chargé d’élaborer et d’approuver les règles mondiales de base pour une valorisation et une utilisation solidaires et durables du bien eau ; juridictionnelle (un Tribunal mondial de l’eau, organe de résolution des conflits en matière d’utilisation de l’eau) et de contrôle (une Agence d'évaluation et de suivi des financements publics pour des projets d’actions communes, internationales et mondiales). Il y a là incontestablement matière à réfléchir, discuter, programmer. L'enjeu : trouver un statut à l'eau.
On saluera à ce niveau l'initiative de l'Unesco – soutenue par le Conseil mondial de l'eau, de promouvoir, développer et soutenir la création et le fonctionnement d'une structure indépendante et facile d'accès qui puisse faciliter la résolution des difficultés liées à la gestion des eaux transfrontalières en proposant les services de techniciens expérimentés, des outils adaptés, des sessions de médiation et des formateurs. Il ne s'agit en aucun cas d'une autorité supranationale dédiée à la gestion des eaux transfrontalières, mais c'est au moins une proposition concrète et qui pourra se développer. Un autre point de satisfaction est à retenir dans l'engagement des organisations internationales et des organismes de recherche d'oeuvrer pour une meilleure compréhension du concept d'eau virtuelle comme moyen efficace de promouvoir la sauvegarde de l'eau et de l'intégrer à part entière aux politiques nationales et régionales (nb. politiques qui restent néanmoins dans beaucoup d'endroits à définir). (L'eau virtuelle consiste en l'eau importée par le biais des achats de produits alimentaires à l'étranger ; bien qu'ignorée des hydrologues, il s'agit d'une ressource importante : selon J. A. Allan, en considérant que depuis la fin des années 1980, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont importé 40 millions de tonnes de céréales et de farine par an, en termes d'eau virtuelle, c'est plus de la moitié de la quantité du Nil utilisée pour l'agriculture dans toute l'Égypte).
Malheureusement ce n'est pas seulement l'eau qui peut être virtuelle, la solidarité internationale aussi. Si celle-ci a été, à Kyoto comme à Johannesburg, au coeur des conversations, elle ne s'est pas franchement concrétisée. Au niveau international, l'aide publique au développement dans le domaine de l'eau représente moins de 10 % de l'aide au développement, soit environ 4,5 milliards de dollars par an pour l'approvisionnement et l'assainissement. "Les évaluations récentes des dépenses requises pour satisfaire aux objectifs adaptés à Johannesburg en matière d'eau impliqueraient au minimum d'augementer les investissements d'au moins 50 % en supplément de l'effort actuel, voire de doubler ces investissements", précise Henri Smets, auteur de plusieurs rapports de l'Académie de l'eau. "Une telle accélération n'est concevable que si l'eau devient une plus grande priorité gouvernementale dans les pays en développement et si l'aide internationale pour l'eau augmente de façon très sensible." Il est clair aussi que PPP ou pas, sans une augmentation importante de l'aide publique au développement dans le domaine de l'eau au bénéfice des pays à revenu faible, les objectifs de la Déclaration du millénaire resteront lettre morte.
En termes absolus le montant des investissements requis ont été évalués à 180 milliards de dollars par an pendant dix ans (rapport Camdessus – soit par rapport aux investissements actuels, 100 milliards de plus par an). De nombreux spécialistes s'accordent sur un montant moindre, à condition que les investissements soient mieux orientés, aux niveaux local et technologique notamment. Quoiqu'il en soit 100 milliards de dollars par an, pendant 10 ans, cela fait... exactement le montant des dépenses militaires annuelles mondiales. Si certains répugnent à ce style de comparaison, il y a là tout de même pour l'eau de quoi se faire amère. Mais le saviez-vous, l'eau serait peut-être schizophrène ? Les propriétés physiques de l'eau liquide ne respectent pas les lois établies pour les autres liquides. Depuis plus d'un siècle, des physiciens soupçonnent que la cause en est un dédoublement de la structure de l'eau. Encore aujourd'hui, ils discutent... Franchement, on le serait à moins. .
Voir aussi : Towards the waters policies for the 21st century - A review
after the World Summit on Sustainable Development in Johannnesburg , by Janos J.
BOGARDI and Andras SZOLLOSI-NAGY, International Hydrological Programme – IHP-UNESCO.
{mospagebreak title=2. La Gestion intégrée des ressources en eau par Jean-François Donzier&heading=1. Les Objectifs du Millénaire sont encore lointains}

Jean-François DONZIER
directeur général de l'Office International de l'Eau
secrétaire du Réseau International des Organismes de Bassin
Comme c'est déjà le cas dans des régions du monde au climat aride et comme l'ont démontré les Conférences Internationales de Paris, de La Haye et de Bonn de mars 1998 et 2000 respectivement, et décembre 2001, ainsi que le Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg en août 2002, la disponibilité de ressources en eau douce continentale, en quantité et qualité suffisantes, court le risque de devenir, d'ici une génération (en 2025), un véritable enjeu de développement économique et social dans la plupart des pays de notre planète. C'est sur cette constatation que la Communauté internationale se mobilise à Kyoto, en mars 2003 pour le 3ème Forum Mondial de L'eau.
Si l'eau est abondante sur la terre, 97 % est de l'eau salée, stockée dans les mers et les océans.
L'eau douce est rare. Sur les 3 % d'eau douce, 70 % sont gelés dans la banquise des pôles et les glaciers des hautes montagnes. L'eau douce liquide, celle dont les hommes pourraient théoriquement disposer pour satisfaire à tous leurs besoins, ne représente donc qu'à peine 1 % de l'eau totale de notre planète et l'essentiel se trouve dans les nappes souterraines. La quantité d'eau douce disponible dans le lit des rivières, les lacs et les marais est en fait dérisoire, dont 15 % du stock mondial dans le seul bassin de l'Amazone.
Les ressources sont mal réparties. L'eau douce est en outre très irrégulièrement répartie entre les régions du monde et sujette à de très fortes irrégularités saisonnières et de grandes fluctuations inter-annuelles. Pour schématiser, ce qui est disponible, c'est en fait la quantité des précipitations qui tombent dans une "cuvette", qui est le bassin versant des fleuves et de leurs affluents, compte tenu de la "fuite" que représentent les écoulements à l'embouchure vers la mer ou l'évaporation. Les lacs naturels ou artificiels, les marais, et nappes souterraines jouent le rôle d'"éponges-réservoirs". Or ces précipitations (pluies ou neige) ne sont pas uniformes, ni dans le temps, ni sur le territoire. On sait tous qu'il y a des pays arides et des pays humides, des années sèches et des années pluvieuses, mais les variations par rapport aux moyennes annuelles sont elles-mêmes considérables. Des pluies peuvent être violentes, se concentrant sur quelques semaines par an et provoquant alors des inondations parfois meurtrières et dévastatrices dont l'essentiel du débit ne peut être stocké et retourne à l'océan, et être suivies ensuite de longs mois de sécheresse, c'est le cas du climat méditerranéen ou des zones de mousson. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'il tombe très fréquemment un petit crachin, sur une longue période annuelle, que l'eau disponible n'est pas globalement rare comme par exemple en Europe du Nord-Ouest.
Rapportées aux populations, les ressources en eau par tête sont révélatrices des niveaux de richesse ou de pauvreté en eau des pays. Elles vont d'une extrême pauvreté avec moins de 100 m3/an/habitant, à la surabondance avec plus de 10 000 m3/an/habitant. Au-dessous du seuil de 1 000 m3/an de ressource naturelle par habitant, des tensions apparaissent entre les besoins et les ressources, notamment lorsque l'irrigation est nécessaire. Le "seuil de pénurie" se situe à 500 m3/an de ressource par tête. D'ores et déjà dans plusieurs pays la quasi-totalité des ressources naturelles renouvelables est déjà exploitée, voire outrepassée. Dans un même pays, les régions sont plus ou moins bien dotées. En Algérie par exemple, 75 % des ressources renouvelables sont concentrées sur 6 % du territoire. L'irrégularité du régime des eaux superficielles impose d'amples efforts de maîtrise par des aménagements régulateurs, mais les équipements les plus faciles, et les moins coûteux, sont déjà réalisés pour la plupart, aussi les opérations de mobilisation des eaux coûtent de plus en plus cher, tout en étant de moins en moins rentables. En outre, l'efficacité des barrages-réservoirs est réduite par la forte évaporation qui affecte les plans d'eau : par exemple, en Égypte, la perte moyenne par évaporation du barrage d'Assouan est de 12 % du débit du Nil.
La compétition est effrénée entre les usagers. L'hydroélectricité, dont le rôle régulateur en période d'inondation ou de sécheresse est indéniable, peut cependant créer localement des perturbations importantes dans le régime des eaux : détournement artificiel de débits élevés vers d'autres bassins, submersion des régions concernées par les lacs-réservoirs, évaporation intense sur les plans d'eau en périodes chaudes, limitation des débits résiduels modifiant l'écologie des cours d'eau d'aval ainsi que la vie de la faune aquatique, remontée de l'eau de mer dans les estuaires, etc. En outre, les barrages sont progressivement comblés par les alluvions produites par l'érosion des bassins versants. Mais la consommation nette de l'hydroélectricité est pourtant très faible car l'essentiel des débits turbinés est restitué à l'aval des usines de production.
Donc, c'est surtout le problème du partage de l'eau entre l'irrigation et les grandes villes qui se pose dans de nombreuses situations. L'agriculture représente de l'ordre de 75 % de la consommation mondiale et sa demande continue de croître compte tenu des impératifs de satisfaction de besoins alimentaires, qui, dans une majorité de pays émergeants ou en développement, nécessitent d'avoir recours à l'irrigation. Les villes, qui regroupent désormais une majorité de la population mondiale, vont également voir leur demande s'accroître pour faire face à leur croissance démographique et au développement industriel et parfois touristique, notamment dans les monstrueuses mégalopoles des Pays du Sud : 550 villes auront plus d'un million d'habitants en 2020.
La surexploitation des nappes d'eau souterraines peut également entraîner leur épuisement, le tarissement des rivières qu'elles alimentent, ou pire encore en zone côtière la remontée des eaux salées ou saumâtres.
La pollution des eaux augmente sensiblement. Avec le développement et la concentration des populations, les pollutions rejetées, industrielles bien sûr, mais aussi urbaines et presque partout agricoles, créent, au moins localement, des situations dangereuses pour l'hygiène et la santé humaine et empêchent la réutilisation successive de la ressource d'amont vers l'aval et dans les nappes. Le traitement des rejets, permettant la réutilisation des eaux épurées, est une nécessité, notamment dans les pays émergeants.
La production d'électricité thermique crée une forte pollution par la température avec la chaleur des eaux de refroidissement rejetée dans le milieu naturel. Les rejets concentrés des eaux usées domestiques ou des eaux toxiques industrielles non traitées ont évidemment des conséquences écologiques considérables.
Mais il faut aujourd'hui surveiller les pollutions diffuses de l'agriculture dues aux déjections des élevages et à l'emploi souvent inconsidéré des engrais chimiques et des produits de traitement phytosanitaire, dont les effets sur les rivières, et surtout les nappes, peuvent être désastreux sur le long terme. L'industrie agricole et alimentaire est source d'une très forte pollution en matière sèche et organique. C'est notamment le cas de la production du café dans certains pays.
Bien sûr, l'extraction de granulats et l'activité minière créent des perturbations énormes du régime des cours d'eau et de l'écoulement des nappes, des risques d'effondrement de terrain et d'érosion, et le traitement des minerais produit des pollutions très significatives en alluvions et en produits toxiques, tel que le mercure.
Aujourd'hui, il est fréquent dans le monde que dans des régions où l'eau n'est pourtant pas rare, son usage soit rendu impossible par la pollution. Les maladies hydriques sont également la première cause de mortalité humaine dans le monde.
On observe un gaspillage inadmissible. Mais dans la majorité des situations, les difficultés proviennent d'abord d'une absence ou d'une insuffisance d'organisation collective et d'une irresponsabilité des consommateurs. Les chiffres avancés, en moyenne mondiale, mettent en évidence des pertes par évaporation et infiltration de l'ordre de 70 % en irrigation traditionnelle. En ville, on estime à 50 % le taux mondial des fuites sur les réseaux d'eau potable. Il est bien clair qu'avant d'aller chercher à mobiliser de nouvelles ressources, la priorité est à un usage optimum des ressources actuelles : donc l'urgence est à la lutte contre les gaspillages.
Les risques naturels sont mal contrôlés. Chaque année à travers le monde les inondations font des milliers de victimes et des milliards de dollars de dégâts. Les sécheresses sont fréquentes et peuvent encore entraîner des famines locales. Enfin la déforestation sauvage et l'élevage intensif mal contrôlé conduisent à une reprise de l'érosion qui se traduit par la perte de milliers d'hectares, aggrave les pics d'inondation et de sécheresse, pollue les rivières du fait de la charge en alluvions, qui aussi colmatent les barrages et réservoirs.
Vers une crise mondiale de l'eau ? L'aridité est malheureusement incontrôlable, sauf par la réalisation de très grands systèmes de transfert d'eau à longue distance, par le prélèvement dans les nappes profondes fossiles lorsqu'il en existe ou en zones côtières par le dessalement d'eau de mer, techniques dont les coûts sont le plus souvent exorbitants. Dans ces conditions, compte tenu de l'accroissement des besoins et des pollutions, l'eau risque de devenir dans beaucoup de régions un facteur limitant du développent futur et l'objet d'âpres compétitions entre ses usagers potentiels. Ces perspectives inquiétantes ne sont pas de la science fiction : d'ores et déjà dans plusieurs pays, les besoins dépassent les ressources renouvelables annuelles et les études prospectives montrent que, sans modifications substantielles des pratiques actuelles, des situations critiques apparaîtront dès la première moitié du siècle, et ceci sur tous les continents.
Il faut donc apporter rapidement des solutions aux problèmes qui se posent ou risquent de se poser à court terme, pour être capables d'assurer une gestion intégrée et durable de l'eau, permettant à la fois :
Il faut faire vite, car il y a urgence et que les solutions possibles n'auront d'effet qu'à moyens et longs termes. C'est donc tout de suite qu'il faut engager à grande échelle les réformes, parfois drastiques, nécessaires et les poursuivre avec opiniâtreté.
Les difficultés rencontrées ne sont pratiquement jamais techniques, même si des adaptations sont encore nécessaires pour les zones rurales et les quartiers urbains défavorisés, mais les principaux problèmes sont liés :
Il y a, de plus en plus, accord des instances multilatérales et des pays pour concevoir une approche moderne de la gestion de l'eau, qui reposerait sur quelques grands principes communs. Cela a été en particulier la grande réussite des Conférences Internationales sur l'Eau, qui se sont tenues à Paris et La Haye en mars 1998 et 2000. Parmi ces principes désormais universellement reconnus, on peut citer :
1. Une vision globale et intégrée
2. Des responsabilités clarifiées
3. Une organisation appropriée
4. Une participation directe et active
5. La lutte contre les gaspillages et la prévention des pollutions
6. L'application du principe "utilisateur-pollueur-payeur"
7. Créer des nouvelles capacités de formation
8. Les connaissances sont insuffisantes
1. Une vision globale et intégrée, visant à la satisfaction optimale de l'ensemble des besoins légitimes, dans le respect des écosystèmes aquatiques.
D'une façon générale dans le Monde, c'est encore malheureusement une gestion éclatée entre secteurs qui prévaut (agriculture, villes, transport, hydroélectricité, industrie...), sans qu'une coordination existe entre les différentes entités administratives sur un même territoire.
Cette gestion suppose que des fonctions soient assurées en permanence de façon complémentaire et cohérente sur l’ensemble des territoires. Il s’agit :
C'est bien l'ensemble de ces fonctions qui doivent être organisées de façon pérenne et dont le financement en investissement et en fonctionnement doit être mobilisé et garanti quelles qu'en soient les modalités.
L'ensemble de ces fonctions n'est jamais assuré par un seul organisme et le cas le plus fréquent est celui de la coexistence, dans un même territoire, de compétences et d'initiatives nombreuses, tant individuelles que collectives, tant publiques que privées.
Un consensus doit être recherché.
Il est donc indispensable d'établir de façon claire, indiscutable et transparente le rôle et les compétences de chacun.
2. Des responsabilités clarifiées.
En particulier : 1) l'administration doit définir un cadre législatif et réglementaire, les normes à satisfaire et les procédures à suivre et disposer de moyens juridiques et techniques afin de contrôler leur application sur le terrain et poursuivre les contrevenants ; 2) la décentralisation des responsabilités et des compétences est à envisager dans le cadre d'une loi générale, afin que les décisions soient prises au niveau où se posent les problèmes et en contact direct avec les usagers ; 3) il faut prévoir l'intervention des organismes publics ou associatifs et des entreprises privées chargés de la gestion collective des services d'eau, dans le cadre d'une réglementation claire. Il faut également assurer leurs activités par des contrats pluriannuels qui définissent le cahier des charges, les tarifs et les moyens de contrôle, en particulier par les autorités réglementaires compétentes et autonomes, avec des pouvoirs suffisants.
3. Une organisation appropriée à l'échelle des grands bassins versants et aquifères.
L'eau ne connaît pas les frontières, et la seule échelle de gestion cohérente est celle des bassins versants ou des aquifères, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers. On estime que les deux tiers des grands fleuves sont transfrontaliers, sans compter ceux partagés entre les différents États de grands pays fédéraux, sans que des accords de gestion n'aient été en général conclu entre les autorités responsables.
C'est un des principes qui fait notamment le succès du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), qui regroupe déjà 149 organismes de 45 pays et dont l'Office International de l'Eau assure le Secrétariat Technique Permanent, avec l'appui des Agences de l'Eau françaises et des Ministères des Affaires Étrangères et de l’Environnement.
Il va de soi que la gestion intégrée des ressources partagées des grands fleuves transfrontaliers sera fondamentale pour l'avenir de certains pays. Il en va de même de la gestion des grands fleuves, lorsque dans des pays fédéraux les responsabilités sont partagées entre le niveau gouvernemental national et les États fédérés.
4. Une participation directe et active des diverses administrations et collectivités territoriales impliquées ainsi, et surtout, de toutes les catégories d'usagers de l'eau.
Ce principe conduit à la mise en place de "Comités de Bassin" fonctionnant en "parlements locaux de l'eau" et compétents pour à la fois :
Il faut désigner les membres de ces instances afin qu'ils soient réellement représentatifs de toutes les catégories d'usagers de l'eau. Il faut également assurer une formation spécifique des délégués et leur fournir des informations appropriées pour qu'ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités.
5. La lutte contre les gaspillages et la prévention des pollutions permanentes ou accidentelles
Il faut d'abord utiliser moins d'eau pour le même résultat, tant en irrigation qu'en industrie ou en ville. Cela suppose la recherche et l'introduction de nouvelles technologies et aussi la nécessité de réduire les fuites, et de recycler et d'éviter de polluer, mais surtout un effort considérable d'éducation et de transformation des comportements :
6. L'application du principe "utilisateur-pollueur-payeur" qui, en rendant la contribution de chacun proportionnelle à ses usages ou aux dommages qu'il cause, est la seule approche économique possible permettant de mobiliser les énormes moyens financiers nécessaires, tout en créant les conditions d'incitation économique auprès des usagers pour réduire le gaspillage et les rejets polluants.
Le recouvrement des coûts est encore trop peu répandu. Dans une majorité de pays, d'énormes réticences culturelles, voire religieuses, s'opposent à une approche industrielle et commerciale de la gestion de l'eau. Or, les investissements à consentir dans les prochaines décennies et les frais d'exploitation et de maintenance des équipements sont considérables et ne pourront pas, dans la plupart des cas, être couverts par les budgets publics nationaux ou locaux traditionnels. On estime à environ 180 milliards de dollars par an sur 25 ans les investissements indispensables pour renverser les tendances actuelles et faire face aux nombreux besoins, notamment d'assainissement.
Toutes les institutions internationales s'accordent désormais pour affirmer qu'il n'y a pas de solution au problème de l'eau en dehors de la participation financière directe des usagers et du secteur privé local. En particulier, il est important d'assurer :
L'expérience montre que des services modernes peuvent être rendus à des coûts faibles, en tout cas raisonnables : par exemple le prix d'un mètre cube d'eau potable, englobant l'assainissement et l'épuration, les redevances et les taxes, ressort en Europe de l'Ouest à l'équivalence de celui de 2,5 litres de super carburant, d'un paquet de cigarettes ou d'une consommation de "soft drink" ou d'un café dans un bar...
Des expériences réussies menées depuis plusieurs décennies montrent que l’ensemble de ces approches financières aux modalités différentiées peuvent permettre, si elles sont mises en œuvre efficacement, de mobiliser en tout cas une part importante des sommes nécessaires à la modernisation du secteur de l’eau et à la préservation de la ressource, replacée dans une perspective à moyen et long terme définissant des objectifs réalistes.
Il est clair que les subventions publiques restent possibles, voire indispensables, en particulier pour compenser les très grandes inégalités entre situations locales ainsi que les péréquations entre les différentes catégories d'usagers, afin de tenir compte de leurs capacités contributives réelles. De même il faudrait concentrer l'aide publique internationale dans les pays les plus démunis sur des projets dont les coûts ne pourraient être équilibrés immédiatement et dont l'efficacité économique et sociale serait forte.
Dans le cadre de contrats pluriannuels, de grandes entreprises privées spécialisées peuvent apporter des compétences et des financements pour faciliter la mise en œuvre de cette gestion industrielle et commerciale des ressources en eau et des services collectifs de qualité. Ces contrats doivent garantir les capitaux investis et leur rémunération, définir les termes de référence des investissements et des prestations, préciser le prix des services et prévoir sur une durée suffisante la bonne fin d'activité.
7. Créer des nouvelles capacités de formation.
Il est indispensable de créer dans les pays des capacités suffisantes de formation professionnelle initiale et continue, notamment dans les secteurs de l'administration, de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance ou des "relations-clientèle" avec les usagers. Compte tenu des effectifs en cause, les formations doivent être organisées sur place, dans la langue et le contexte de chaque pays et avec des formateurs locaux, et être plus orientées vers l'apprentissage pratique "au poste de travail" que vers la théorie.
La formation des agriculteurs, notamment des irrigants, est aussi à renforcer, voire à réorganiser. Si, de plus en plus, les ingénieurs de projet sont de bon niveau, les gestionnaires et les exploitants sont encore le plus souvent trop peu nombreux. La formation initiale des techniciens, ouvriers et des administratifs reste balbutiante et plus théorique que réellement pratique. La formation professionnelle continue reste à organiser.
Les décideurs doivent aussi, et peut-être surtout, être mis à même d'exercer leurs responsabilités, qu'il s'agisse d'élus nationaux ou locaux, de chefs d'entreprises, de responsables professionnels, de dirigeants d'associations ou d'ONG, un apprentissage approprié à leur situation doit être envisagé dans le secteur de l'eau, et en priorité pour les membres des comités de bassin.
8. Les connaissances sont insuffisantes.
Il n'existe encore que trop rarement des systèmes d'information – réseaux de mesures et d'analyses, banques de données – qui soient représentatifs de la qualité et de la quantité disponible des ressources en tous points et à toutes périodes, ainsi que des prélèvements et des rejets et qui soient fiables et accessibles à tous : comment bien gérer alors ce que l'on connaît si mal ?
L'amélioration des connaissances passe par la recherche, bien sûr, mais surtout par la création de ces systèmes d'information globaux et intégrés qui soient fiables et accessibles à tous, et en particulier aux membres des comités de bassin. Il s'agit également de permettre à tous les opérateurs des bassins d'avoir accès, le plus largement possible, au savoir-faire dans le domaine de l'eau, et que celui-ci soit présenté sous une forme facilement accessible et soit d'utilisation facile et compréhensible.
Conclusions
Si le chemin est encore long avant que ne soient partout appliqués les principes d'une gestion appropriée et durable des ressources, permettant la satisfaction des besoins des générations futures, cependant, la direction est aujourd'hui plus clairement définie et les solutions proposées, notamment par la Conférence Internationale de Paris en mars 1998, sont crédibles et applicables. .
{mospagebreak title=3. Promouvoir les partenariats public-privé par Pierre Jacquet}
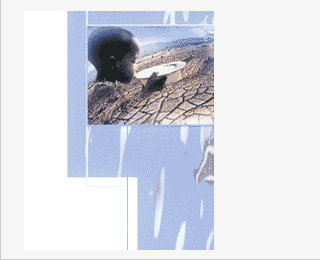
Pierre JACQUET
chef économiste à l’Agence française de développement – AFD
L’auteur remercie Olivier CHARNOZ pour sa contribution à la rédaction de cet article
Bien conçus, les partenariats public-privé (PPP) représentent l’un des débouchés les plus prometteurs de l’aide publique au développement (APD). C’est pour cette raison que chaque nouvelle conférence – Monterrey, Johannesburg, Kyoto, etc. – les a placés un peu plus au cœur de l’actualité. Leur principe ? Réunir autorités publiques et agents privés pour concevoir, financer, construire, gérer ou préserver un projet d’intérêt public. Les PPP supposent un partage de responsabilité et de propriété, entre gouvernement et secteur privé – un partage garanti par contrat de longue durée. Parmi les secteurs typiquement ou potentiellement concernés : l’eau potable, l’assainissement, les transports, les infrastructures de communication, la santé, l’éducation.
Les PPP ne sont pas une "recette" que le Nord réserve au Sud. De nombreux pays riches ont adopté cette démarche dans l’intérêt de leur propre population. Deux motivations fondamentales expliquent ce choix. D’abord la recherche d’une plus grande efficacité dans l’utilisation des fonds publics, d’un meilleur rapport qualité/prix de certains services d’intérêt commun. Pour des raisons dues à la connaissance des marchés ou à la structure des incitations, les bonnes décisions – technologiques et managériales – seront souvent plus facilement et plus rapidement prises lorsqu’un capital privé est en jeu. De là une réduction des coûts, à qualité constante, dont le contribuable entend bénéficier.
Ensuite, le secteur privé délivre le public d’une partie du risque financier lié aux investissements en infrastructures. Un recours aux capitaux privés réduit aussi le besoin d’endettement public. Certes, les autorités doivent en général garantir à l’opérateur privé une rétribution. Toutefois, dans le cas d’un PPP, ce paiement est conditionné aux résultats effectifs de l’opérateur – des résultats qui doivent se conformer à un cahier des charges précis, ce qui le distingue du service d’une dette dont la contrepartie n’est pas toujours évidente.
Ces deux familles d’arguments acquièrent une intensité particulière dans le contexte des pays en développement (PED). L’expertise technique et le capital humain drainés par le secteur privé international bénéficient d’autant plus aux pays qui en manquent structurellement. Le secteur privé local peut lui aussi jouer un grand rôle : il connaît les contraintes et les pratiques du terrain ; il est économiquement incité à contourner celles qui nuisent à la viabilité du service – contrairement, parfois, à un agent public. Enfin, les contraintes de financement qui pèsent sur les budgets des PED (suite à l’absence de classe moyenne, à la faiblesse du système fiscal ou encore à leur endettement) rendent essentiel, voire vital, l’appel aux capitaux privés.
De fait, en dépit de récents progrès, les besoins des PED en services essentiels demeurent considérables. Seuls deux êtres humains sur cinq disposent d’un accès régulier à l’eau potable ; moins de 10 % des eaux usées de la planète sont traitées ; plus de deux milliards d’individus sont privés d’électricité (75 % de la population du Ghana par exemple) ; une écrasante majorité de pays africains ne dispose même pas d’un médecin pour 10 000 habitants (quand il y en a 30, par exemple, en France). L’insuffisance des financements publics est claire. Dans le secteur de l’eau par exemple, ils couvriront au mieux 15 % des besoins en infrastructures ces prochaines années.
Associer fonds publics et privés est donc impératif – à une toute autre échelle que celle qui prévaut aujourd’hui. En 2000, près de 150 chefs d’État et de gouvernements ont adopté aux Nations unies la "Déclaration du Millénaire" – un ensemble d’objectifs mondiaux de développement à l’horizon 2015 : lutte contre l’extrême pauvreté et la faim, contre la mortalité infantile et maternelle, contre les pandémies ; promotion de l’éducation universelle, de l’égalité des sexes ; diffusion de l’accès à l’eau et à l’assainissement… Autant de croisades modernes qui nécessiteront, chaque année pendant quinze ans, un doublement de l’APD mondiale. Autant dire que les "Objectifs du Millénaire" sont durablement hors de portée des seuls fonds publics, malgré le regain d’intérêt dont l’APD bénéficie de nos jours.
Certains critiquent les PPP sous prétexte qu’ils reviendraient à "rendre service aux multinationales". Ce sont souvent les mêmes qui s’opposent à la fourniture des services de base aux populations par le secteur privé parce qu’elle représenterait un marché pour les entreprises, comme si on pouvait se passer de ces dernières. Or, les entreprises étrangères sont globalement peu présentes dans les pays pauvres. La présence de multinationales ne garantit certes pas un développement harmonieux. Mais leur absence contribue à maintenir les pays pauvres dans le piège du sous-développement.
Force est cependant de constater que les PPP ne se développent pas naturellement, du fait de l’intérêt insuffisant, précisément, des partenaires privés. Face à la montée des risques-pays, du risque de change et des sanctions infligées par les marchés financiers aux firmes qui maintiennent ce type d’exposition internationale, et suite à la grave crise argentine, les flux d’investissements privés ont en effet marqué le pas.
Comment comprendre ce reflux ? Est-il toujours l’expression de décisions informées, rationnelles, "efficaces" du point de vue économique ? Certains observateurs ont souligné par exemple que le retour sur investissement en Afrique est tellement faible qu’il est parfaitement rationnel et conforme à l’allocation optimale des ressources que son volume le soit également. Manque d’ouverture commerciale, faible capital humain, environnement risqué, infrastructures défaillantes : voilà comment s’expliquerait rationnellement le triste sort de l’Afrique sub-saharienne, repoussoir de l’investissement privé .
Cependant, la marginalisation de nombreux pays pauvres renvoie aussi à des défaillances de marché auxquelles l’APD peut apporter des réponses, notamment à travers les PPP. Prenons l’exemple de l’information imparfaite des agents – une imperfection particulièrement coûteuse pour les PED et leur développement. L’information a un coût que nul agent isolé n’a intérêt à prendre en charge seul, car elle constitue au moins en partie un bien public. La mise en place de PPP, à l’initiative d’une agence de développement et des autorités publiques, peut exercer un fort effet de signal à l’attention des investisseurs privés, et compenser ainsi le manque d’information sur le climat d’investissement et les intentions des gouvernements.
Autre exemple : les risques non-commerciaux. Risques pays, rupture des contrats, risques politiques, corruption… L'investissement direct étranger est très sensible aux conditions de la gouvernance locale. Les entreprises qui hésitent à intervenir dans les PED peuvent changer d’avis si des bailleurs de fonds (qui connaissent le terrain, les autorités publiques et dont la présence rassure) prennent en charge une partie du risque inhérent à ces géographies. Les agences d’aide peuvent proposer de nouveaux instruments de couverture, en contrepartie d’engagements précis de chacun des acteurs d’un PPP – d’où l’importance de la conditionnalité pour les pays bénéficiaires et de cahiers des charges précis et exigeants pour les entreprises. De tels partenariats peuvent mobiliser des investissements privés pour des projets d'utilité sociale.
Le succès d’un PPP dépend de façon déterminante du régulateur public. Sa défaillance et son manque d'ascendant sont souvent source de fautes trop vite imputées aux seules entreprises : iniquité sociale, tarifs fluctuants, corruption, normes sanitaires et sociales incertaines, sous-investissement. Il faut donc accorder la plus haute importance aux mécanismes de régulation. Pour arbitrer intérêts publics et contraintes privées, l’une des voies à suivre semble être la mise en place de régulateurs indépendants, au dessus de tout soupçon, comme par exemple des agences régionales.
Les agences d’aide, bilatérales et multilatérales, ont un rôle majeur à jouer pour soutenir l’effort d’aide publique au développement. Elles doivent pour cela apporter la preuve de leur efficacité. L’une de leurs responsabilités consiste à savoir mobiliser, à partir de fonds publics limités, des ressources suffisantes pour assurer la fourniture des services essentiels aux populations des pays pauvres. Les PPP fournissent un instrument particulièrement adapté, leur permettant d’associer, à chaque mise de fonds publique, la participation d’entreprises locales ou étrangères prêtes, dans le cadre d’une relation contractuelle exigeante, à prendre le risque de l’investissement. C’est ce risque, et l’espoir de profit social et privé qui l’accompagne, qui fonde toute dynamique de croissance durable. .
|
{mospagebreak title=4. Pour un nouveau PPP : le partenariat public-public par Riccardo Petrella}

Riccardo PETRELLA
professeur à l’Université Catholique de Louvain
conseiller à la Commission européenne
L’idée d’un partenariat public-privé (PPP) remonte au moins à la fin du 19ème siècle lorsque aux États-Unis, en pleine expansion d’un capitalisme sauvage, on privatisa le secteur des télécommunications. À cette occasion on inventa la notion de "service universel" par lequel la prestation des services communs jusqu’alors publics, était confié à des opérateurs privés – en régime "qui auraient dû être concurrentiels" – dans le cadre d’un contrat public privé où le public gardait la propriété du service, fixait les règles (en termes d’obligations, conditions, et modalités des prestations, de tarifs…) et maintenait, grâce à une autorité ad hoc, le pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat.
Le partenariat public privé est une des réponses préférées – notamment dans la deuxième moitié du 20ème siècle – données par les classes dirigeantes des pays occidentaux à la question de savoir quel doit être le rôle des pouvoirs publics, en particulier de l’État et des collectivités locales, dans l’économie (c’est à dire dans la fixation des règles définissant la propriété des biens et des services ainsi que les processus de décision et de gestion en matière d’allocation des ressources matérielles et immatérielles disponibles pour la production , la consommation et la protection notamment des biens et des services considérés essentiels à la vie individuelle et au vivre ensemble).
La base théorique sur laquelle se fonde le PPP relève à la fois des principes de l’économie libérale capitaliste de marché et des principes de l’économie "sociale" corporatiste. En ce qui concerne le premier groupe de principes, la thèse consiste à dire que le rôle de l’État doit être principalement un rôle d’encadrement et de régulation générale. De nos jours, cela signifie que le rôle principal de l’État serait de définir et promouvoir (y compris par exemple dans le domaine de la R&D, de l’éducation, des infrastructures de base…) l’environnement général le plus favorable au fonctionnement de l’économie capitaliste de marché, n’intervenant qu’exceptionnellement dans la vie économique pour corriger les "échecs du marché" (market failures). En ce qui concerne le deuxième groupe de principes, la conception sous-jacente affirme que chaque groupe social, chaque groupement d’intérêt doit être en mesure de s’organiser en tant que tel et qu’il revient à l‘État de favoriser la cohésion entre ces multiples corporations d’intérêt promouvant une coopération publique privée étroite.
L’ensemble de ces principes a donné naissance à de multiples formes de collaboration publique privée dans des sociétés d’économie mixte (les SEM) en France ou en Allemagne, en fonctionnement depuis plusieurs décennies, représentent l’archétype de modèle de PPP préféré, par exemple, plus près de nous, par la Banque Mondiale. Une variante de cette économie mixte qui a eu une grande diffusion en France dans le domaine des services d’eau est la privatisation de ces services fondée sur le principe de la gestion déléguée. Selon ce système, l’État garde la propriété du bien (dans ce cas l’eau) ainsi que du réseau infrastructurel de base, et délègue au privé la gestion par un contrat d’affermage ou de concession, tout en conservant – affirme-t-on – le pouvoir de contrôle politique sur la gestion.
Il y a deux arguments en faveur de ce PPP.
Primo, on doit faire une nette distinction entre propriété et gestion d’un service, la gestion pouvant, voire devant, être confiée au privé car "les privés gèrent mieux", "le privé est plus efficace", "le privé sait mieux répondre aux besoins diversifiés changeants des consommateurs". Secundo, ce qui compte pour le politique c’est de maintenir le pouvoir de contrôle sur la gestion.
L’expérience pluri-décennale française, américaine, et plus récente, britannique, démontre que les deux arguments ne tiennent pas debout. D’une part le privé est loin d’être toujours aussi efficace qu’il le prétend. Les pays scandinaves ou la Suisse montrent que le "tout public" n’a rien à envier au privé sur le plan de l’efficacité. Comme d’ailleurs on doit aussi considérer que "le tout public" n’est pas toujours un exemple de bonne gestion. D’autre part, au fil des années, dans le cadre d’un contrat de gestion d’une durée de 20 à 30 ans, le pouvoir public perd la capacité réelle de contrôle sur le privé car c’est ce dernier qui acquiert définitivement les connaissances nécessaires et indispensables sur le pan scientifique, technologique, gestionnaire et financier, sur la base desquelles on peut prendre les décisions. Formellement, le pouvoir de décision et de contrôle demeure dans le derechef des pouvoirs publics. De facto, elles en sont dépossédées.
Au-delà du débat sur l’efficacité comparée privé versus public, trois raisons m’amènent à défendre la solution du "tout public" et à proposer le rejet du PPP dans le cas des biens et des services considérés essentiels à la vie individuelle et au vivre ensemble des êtres humains.
Primo, le PPP favorise la marchandisation des biens et des services tombant sous son régime, malgré les dénégations formelles de ses promoteurs. La santé, l’éducation, l’eau pour ne mentionner que les exemples plus significatifs sont réduits à des marchandises comme le pétrole, les légumes, les loisirs. On ne peut pas marchandiser le droit à la vie et la dignité humaine.
Secundo, le PPP se traduit par la privatisation du politique, le pouvoir réel de décision en matière d’allocations des ressources passant des sujets publics à des sujets privés.
Tertio, le PPP contribue à transformer la nature de l’État et des collectivités territoriales publiques en les faisant devenir des entreprises de type privé. Même si les entreprises publiques de gestion des services d’eau gardent la majorité du capital, elles opèrent comme n’importe quelle autre entreprise capitalistique privée. De facto une collectivité locale possédant la majorité du capital d’une entreprise publique privée devient à plein titre effectif un sujet opérant dans ce marché financier compétitif et obéissant à des logiques capitalistiques financières. Elles cessent dès lors d’être un sujet collectif.
Les trois dérives graves dont ci-dessus deviennent encore plus évidentes au plan international et mondial. C’est le cas du principe de conditionnalité imposé par la Banque Mondiale à tout pays demandant un prêt. L’octroi du prêt est lié à la condition que le pays procède à la libéralisation et à la déréglementation (ce que de fait se traduit par la privatisation) du secteur pour lequel le pays obtient le crédit. Par l’imposition de ce partenariat public privé, la Banque Mondiale a favorisé au cours des 25 dernières années la prise de contrôle et la mainmise par les entreprises multinationales privées (à savoir occidentales) de la plupart des ressources naturelles d’un nombre considérable de pays d’Afrique, d’Amérique Centrale et Méridionale et d’Asie. Aux mêmes résultats ont abouti et aboutissent d’une part les mesures de libéralisation et de déréglementation des services publics conséquents à la création du Marché Unique européen de l’Union européenne et d’autre part, les négociations pour un Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) dans le cadre de l’OMC, si elles aboutissent, conformément aux objectifs affichés par l’OMC.
Le principe de base de cet autre PPP réside dans le fait que tous les biens et les services considérés essentiels à la vie et au vivre ensemble doivent être considérés comme des biens communs, des biens communs globaux, mondiaux et que l’accès à ces biens et services doit être reconnu comme un doit humain universel, indivisible, imprescriptible.
Dès lors, le partenariat public-public signifie qu’aucun sujet même public n’est propriétaire patrimonial à titre souverain et exclusif des biens et des services communs. Ma thèse est qu’il ne peut pas y avoir de "souveraineté communale" ni de "souveraineté nationale" dans ce domaine mais, au contraire, partage total de pouvoir de décision et de contrôle et solidarité (c’est-à-dire co-responsabilité, "in solido") entre les différents niveaux institutionnels publics. Ceci implique et impose une logique et une pratique de coopération et de partenariat entre les différents niveaux institutionnels.
Qu’il s’agisse de l’eau ou de la protection de la biodiversité, des soins de santé ou de la connaissance, de l’énergie solaire ou de l’éducation, des pensions de vieillesse ou de la culture, il ne peut pas y avoir de marché mondial mais c’est de la responsabilité des pouvoirs publics de prendre soin, garantir et valoriser dans la coopération et non pas dans la compétition, dans l’intérêt de tous (y compris les générations futures) et de l’éco-système Terre ces biens et ces services essentiels à la vie et au droit à la vie. Ce soin, cette garantie et cette valorisation ne peuvent se faire que dans le cadre d’une réelle démocratie participative même au niveau international et mondial. C’est là l’un des défis majeurs de la créativité et de l’innovation de nos sociétés pour les années à venir. En effet, les logiques de guerres commerciales, technologiques, financières, auxquelles n’échappe point la pratique du partenariat public privé, à la base de la violence qui caractérise aujourd’hui les sociétés contemporaines et le phénomène de mondialisation sont contraires à l’esprit de démocratie et de paix. .
{mospagebreak title=5. Le droit à l'eau au Forum de Kyoto par Henri Smets}

Henri SMETS
Conseil européen du droit de l’environnement – CEDE
“L’eau est indispensable à la vie et à la santé. Le droit de l’être humain à l’eau est donc fondamental pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne. C’est la condition préalable à la réalisation de tous ses autres droits.”
C’est avec ces mots que le Comité des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a pris aujourd’hui l’initiative sans précédent d’inclure une “observation générale” sur l’eau en tant que droit de l’être humain. Par “observation générale”, on entend une interprétation des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. Les 145 pays qui l’ont ratifié seront désormais tenus d’assurer progressivement l’accès universel à de l’eau de boisson sûre et saine et à l’assainissement, de manière équitable et sans discrimination (Communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la santé, 27 novembre 2002).
Depuis novembre 2002, le droit à l'eau est reconnu officiellement au plan international comme étant un droit fondamental au même titre que le droit à la nourriture ou le droit à la santé. En effet le Comité des droits économiques, sociaux et culturels chargé de suivre la mise en œuvre du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels a adopté une Observation générale n° 15 qui met fin à une période d’incertitude.
Le droit à l’eau est désormais un droit fondamental car il est indispensable pour mettre en œuvre le “droit à un niveau de vie suffisant” (Art. 11) ou “le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre” (Art. 12 du Pacte). L’adoption de cette interprétation concerne tous les 146 États qui ont ratifié le Pacte de 1966... mais pas les 46 États qui ne l’ont pas ratifié. Le droit à l’eau figure aussi dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 (170 ratifications) et dans la Convention sur les droits de l’enfant de 1989 (191 ratifications). Les États-Unis sont les seuls à n’avoir ratifié aucune convention où figure le droit à l’eau.
À la suite de la décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’OMS a publié un rapport très intéressant sur “Le droit à l’eau” explicitant ses implications.
La reconnaissance formelle du droit à l'eau avait été précédée de nombreuses déclarations au plan international. Selon M. K. Annan, Secrétaire général des Nations unies, l’accès à l’eau est un “droit fondamental de l’homme”. Pour l’OMS, “l’accès à l’eau saine et suffisante est un droit de l’homme” ou encore “l’accès à l’eau salubre et à des moyens d’évacuation salubre des excréta est un besoin universel et, à la vérité, un droit fondamental de l’homme”. En France, l’Académie de l’eau avait inscrit en 2000 dans sa Charte sociale de l’eau que l’accès à l’eau était un “droit inaliénable”.
Juste avant le Forum, le Saint Siège a publié un message d’un haut intérêt (“Water, an essential element for life”) selon lequel : “There is a growing movement to formally adopt a human right to water. The dignity of the human person mandates its acknowledgment. ...The right to water is thus an inalienable right” (Traduction : Il existe un mouvement croissant pour reconnaître formellement le droit de l’homme à l’eau). La dignité de la personne humaine exige sa reconnaissance... Le droit à l’eau est donc un droit inaliénable.
Le Panel présidé par M. Michel Camdessus et réunissant des hautes personnalités liées au monde de la finance a produit le plus important Rapport présenté à Kyoto : “Financer l’eau pour tous”. Ce Rapport comporte entre autres l’affirmation selon laquelle “l’accès à l’eau constitue un droit et un besoin fondamental” et que “l’eau et l’assainissement doivent être accessibles à tous, à un prix abordable”. Il ne s’agit pas d’une voix isolée puisque le vice-président de la Banque mondiale, M. Peter Woicke considère que “access to safe water is and should be regarded as a human right” – Int. Herald Tribune, 17 mars 2003 (Traduction : l’accès à l’eau est et devrait être considéré comme un droit de l’homme).
Dans le monde des affaires, le PDG de Suez, M. Gérard Mestrallet a déclaré dès 2001 que “le droit universel de l’accès à l’eau doit être reconnu”. De son côté, la Générale des Eaux reconnaît l’existence de “l’impératif social du droit à l’eau pour tous”. Le Conseil Mondial de l’Eau considère que l’eau est un droit fondamental de l‘homme.
Toutes les ONG militent depuis longtemps pour la reconnaissance du droit à l’eau. À Kyoto, M. Mikhail Gorbachev, au nom de Green Cross International, s’est prononcé pour l’inclusion du droit à l’eau dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et Mme Hilda Grace Coelho, au nom des ONG à Kyoto, a estimé que l’accès à une eau saine et abordable est un droit de l’homme auquel la déclaration ministérielle devrait faire référence.
Le 3ème Forum mondial de l’eau s’est ouvert par un message de M. Jacques Chirac, Président de la République dans lequel il propose que “l'accès à l'eau soit reconnu comme un droit fondamental”. Il ajoute que “l'eau est par nature un bien public. Nul ne saurait se l'approprier. C'est à la collectivité d'en définir l'usage pour assurer un bon approvisionnement et un bon assainissement, pour limiter les gaspillages, dans un esprit de justice sociale, de saine économie et de respect de l'environnement.”.
Nombreux sont les défenseurs, surtout parmi les ONG, d’une position selon laquelle l’accès à l’eau est un droit humain qui devrait être érigé en valeur universelle respectée par tous les gouvernements. Un grand nombre de décideurs estiment quant à eux que les déclarations des droits de l’homme en vigueur stipulent déjà de manière suffisamment claire que l’accès à l’eau fait partie des besoins humains essentiels et que des déclarations supplémentaires sont inutiles et politiquement trop complexes (Extrait de : Pas d’avenir sans eau : Contribution du Prince d’Orange, août 2002).
À Kyoto, quelque 100 ministres et hauts fonctionnaires ont discuté de l’inclusion éventuelle dans la Déclaration ministérielle d’une référence à l’Observation générale n° 15 sur le droit à l’eau adoptée en novembre 2002. Le Royaume-Uni a proposé que les Ministres s’engagent à débattre des implications de cette Observation au plan interne. Cette proposition n’a pas été retenue et le texte adopté à Kyoto quelques jours après le début de la Guerre d’Irak ne contient rien sur le droit à l’eau. Ce n’était pas vraiment une surprise, malgré les efforts de dernière minute des ministres européens.
Cette situation s’explique par le fait que le droit à l’eau est devenu “politiquement incorrect” pour certains (comme d’ailleurs tout ce qui implique des droits sociaux ou aurait des incidences négatives sur le libre jeu des forces du marché), qu’il imposerait des obligations excessives à certains pays et que sa reconnaissance pourrait avoir des incidences juridiques insoupçonnées. La prudence consiste à ne rien dire même dans un texte sans la moindre portée juridique et, en tout cas, à ne pas donner une base quelconque à des réclamations de populations sans accès à l’eau.
Un autre argument est que la reconnaissance du droit à l’eau serait incompatible avec la reconnaissance que l’eau est une marchandise. Ce dernier argument est sans fondement car la nourriture est à la fois un droit et une marchandise. En outre, l’eau n’est pas une “marchandise comme les autres” (du moins pour l’Union européenne). Pour certains observateurs, le concept de droit à l’eau compliquerait la mise en place d’une tarification appropriée de l’eau et retarderait la mise en place de l’obligation de payer le service de l’eau. À nouveau, il s’agit d’une erreur conceptuelle car le droit à l’eau n’est pas forcément le droit à l’eau gratuite pour tous et que dans toutes les civilisations, les porteurs d’eau étaient et sont encore payés. La gratuité de l’eau est un concept généreux mais inappliqué car dans les pays où l’eau manque, les plus pauvres payent l’eau très cher ou consacrent beaucoup de leur temps et de leurs forces à chercher de l’eau.
Le refus de certains ministres de reconnaître ne fut-ce que l’existence d’un rapport officiel des Nations unies sur le droit à l’eau n’a pas d’importance au plan juridique car le droit international découle des traités et non des déclarations politiques. Toutefois, c’est un acte politiquement préoccupant car il jette un doute sérieux sur la crédibilité des engagements et des déclarations des gouvernements de réduire d’un facteur deux la proportion des personnes sans accès à l’eau avant 2015 (Déclaration du Millénaire, Déclaration de Johannesburg). Ne s’agirait-il finalement que de promesses creuses, si creuses que les ministres présents à Kyoto n’ont même pas réussi à créer, comme le demandait la France, un observatoire impartial pour suivre la mise en œuvre de cet engagement ? Tout ce qu’ils ont réussi à convenir est que : “Ways to track progress on water issues may be usefully explored on the basis of existing facilities and relying upon information from countries and relevant UN agencies, regional development banks and other stakeholders, including civil society organizations”. “Usefully explored”, la dérobade est totale ...et l’on comprend les commentaires très négatifs portés sur la déclaration par ceux-là même qui l’ont adoptée. (Traduction : les méthodes pour assurer le suivi des progrès accomplis sur les questions de l’eau devraient être explorées sur la base des dispositifs existants et en se fondant sur les informations des pays et des agences des Nations unies, des banques régionales de développement et des autres partenaires, y compris les organisations de la société civile).
Au cours du Forum de Kyoto, Mme Myriam Constantin (Mairie de Paris) a présenté une déclaration au nom de huit associations de maires de France (dont l’AMF) sur l’accès à l’eau et l’assainissement selon laquelle “l’accès à l’eau potable est un droit fondamental de tout individu”. Les maires de France marquent leur attachement au principe de l’universalité et de l’imprescriptibilité du droit d’accès. Ils s’engagent à assurer une gestion des services de l’eau et de l’assainissement permettant à tous d’accéder à l’eau et à l’assainissement et à “recourir, si nécessaire, à des dispositions sociales ou à des mécanismes de solidarité appropriés en direction des populations défavorisées”.
L’importance de cette déclaration doit être soulignée car elle marque la prise de conscience des collectivités locales concernant un problème qui est davantage le leur que celui des organes centraux.
Adopter le droit à l’eau au plan international et le mettre en oeuvre dans un contexte national sont deux choses très différentes. L’application du texte international passe par une analyse concrète des difficultés rencontrées par les personnes qui n’ont pas accès à l’eau dans un contexte juridique, politique, économique et social particulier. La plupart des personnes sans accès à l’eau sont bien évidemment dans les pays les plus pauvres. Pour ce qui est de la France, la situation est différente car les services de l’eau y sont très développés, la pauvreté y est très limitée et le droit y est bien respecté. On n’exclut pas telle personne de l’accès à un puits parce qu’elle est impure, on ne détruit pas les réservoirs d’eau sur les toits, les source d’eau potable ne sont pas détournées au bénéfice d’autres intérêts et personne ne doit marcher des km pour obtenir un récipient d’eau impure. Les réseaux d’eau potable vont jusqu’au fond des banlieues les plus pauvres et l’on crée au minimum une borne-fontaine sur la place des villages. Mais pour que le droit à l’eau soit une réalité pour tous, il convient de le définir afin de faire passer les déclarations faites à Kyoto dans la réalité. Ce chantier pourra être entrepris dans le cadre de la nouvelle loi sur l’eau en préparation.
Le droit à l’eau n’est pas simplement le droit de pouvoir disposer de la ressource en payant le prix demandé. Il oblige les États à prendre des mesures pour que chaque personne en vertu d’un droit individuel et non d’un acte de charité, puisse disposer de l’eau potable nécessaire à ses besoins essentiels.
“Le droit à l’eau comme à la nourriture ne signifie pas que l’eau ou la nourriture soit gratuite ; il signifie seulement que l’eau soit d’un prix abordable de sorte que chaque personne puisse en disposer. Ceci implique en particulier que les plus déshérités devront recevoir de l’eau de façon gratuite ou quasi gratuite mais nullement que chacun a droit à recevoir de l’eau à bas prix.” (H. Smets : Le droit à l’eau, Académie de l’eau, 2002).
Un État qui reconnaît l’existence du droit à l’eau n’est nullement tenu de distribuer 40 litres d’eau gratuitement à tous ces citoyens comme le demandent vainement certains associations. Il en est de même pour la nourriture : les boulangers ne sont pas tenus de distribuer du pain gratuitement. Pour respecter le droit à la nourriture, des aides sociales sont allouées et des distributions gratuites sont organisées pour ceux qui sont dans le besoin.
Dans un pays comme la France, le droit à l’eau signifie que toute personne, sans discrimination et quel que soit son niveau économique, doit disposer pour ses besoins essentiels d’une certaine quantité d’eau ayant une qualité satisfaisante. En premier lieu, il implique une obligation d’approvisionnement en eau saine à un prix abordable, obligation satisfaite dans une très large mesure.
La reconnaissance du droit à l’eau oblige les pouvoirs publics à organiser, surveiller et contrôler l’approvisionnement en eau potable, à protéger la ressource et à prendre des mesures raisonnables pour que l’eau ne vienne pas à manquer. Elle oblige à intervenir dans les cas les plus dramatiques et à ne pas tolérer les abus les plus criants.
La reconnaissance du droit à l’eau présente un intérêt tout particulier pour toutes les personnes qui n’ont pas accès à l’eau, en particulier celles en situation de précarité et celles éloignées des sources d’eau potable. Lorsque l’eau est difficilement accessible ou que son prix devient inabordable pour certaines personnes vu leur faible niveau de revenu, il est nécessaire que la société intervienne pour leur permettre d’acquérir une quantité limitée d’eau sans y consacrer une part trop importante de leurs revenus ou de leur temps.
L’intervention de la société dans le secteur de l’eau a un coût qui doit être financé. Les moyens financiers nécessaires sont déployés progressivement, ce qui permet de mettre en œuvre le droit à l’eau. Il y a 150 ans, il fallait chercher l’eau qui coulait gratuitement aux fontaines publiques, aujourd’hui elle est dans toutes les habitations mais il faut payer le service.
1. toute personne proche d’une source d’eau a droit d’en bénéficier et toute personne proche d’un réseau a droit de s’y brancher sans soumettre ce droit à une condition de ressources, de nationalité ou d’occupation régulière (accès universel) ;
2. une personne qui disposait d’eau ne peut en être privée (ceci signifie notamment qu’en cas de coupure d’eau, il faudra organiser une alimentation de secours et que les populations ne peuvent pas être privées de l’eau nécessaire à leur dignité ou à leur survie économique dans le milieu où elles ont l’habitude de vivre) ;
3. des mesures d’urgence doivent être prises si l’eau vient à manquer (accident, sécheresse, catastrophe naturelle) ou à être polluée ; en particulier, les pouvoirs publics doivent organiser la distribution d’eau de boisson salubre en cas de pénurie ;
4. toute personne prise en charge par les pouvoirs publics doit recevoir l’eau indispensable à sa dignité (par exemple, les personnes sans abri et les exclus doivent recevoir l’eau pour boire mais aussi l’accès aux douches).
Pour tenir compte des problèmes économiques soulevés par le paiement de l’eau (de plus en plus chère), il convient de prendre des mesures de tarification ou d’aides pour rendre le prix de l’eau moins lourd dans les budgets des plus défavorisés (mise en oeuvre de la solidarité entre les riches et les pauvres).
En pratique, le droit à l’eau est d’ores et déjà mis en œuvre en France dans la très grande majorité des cas. En outre, ce droit peut être invoqué avec succès devant les tribunaux, soit pour obtenir le rétablissement de l’alimentation coupée par le distributeur pour cause d’impayé, soit encore pour obtenir un branchement au réseau refusé par un maire.
Toutefois il reste encore quelques cas limites nécessitant une attention particulière :
1. l’accès à l’eau dans les hameaux mal desservis (une centaine) ou dans les villages où l’eau est peu salubre ;
2. l’accès à l’eau des plus démunis (plus d’un million de personnes) ;
3. l’accès à l’eau des gens du voyage (un peu plus de cent mille).
En plus, il faut financer l’aide pour l’eau dans le Tiers Monde (actuellement environ 150 millions de dollars par an an payés par la France).
Le projet de nouvelle loi sur l’eau devrait donner au Gouvernement la possibilité de proposer les mesures nécessaires pour que le droit à l’eau promu par le Président de la République au plan international devienne une réalité pour tous sur le territoire national. À cet effet, il faudrait au minimum inclure dans le texte en préparation l’affirmation de l’existence du droit à l’eau en droit français. Les propositions françaises en matière de charte des services essentiels et la doctrine de l’École française de l’eau devraient également se refléter dans le projet de loi en préparation, ce qui leur donnerait une plus grande légitimité au plan international. .
|